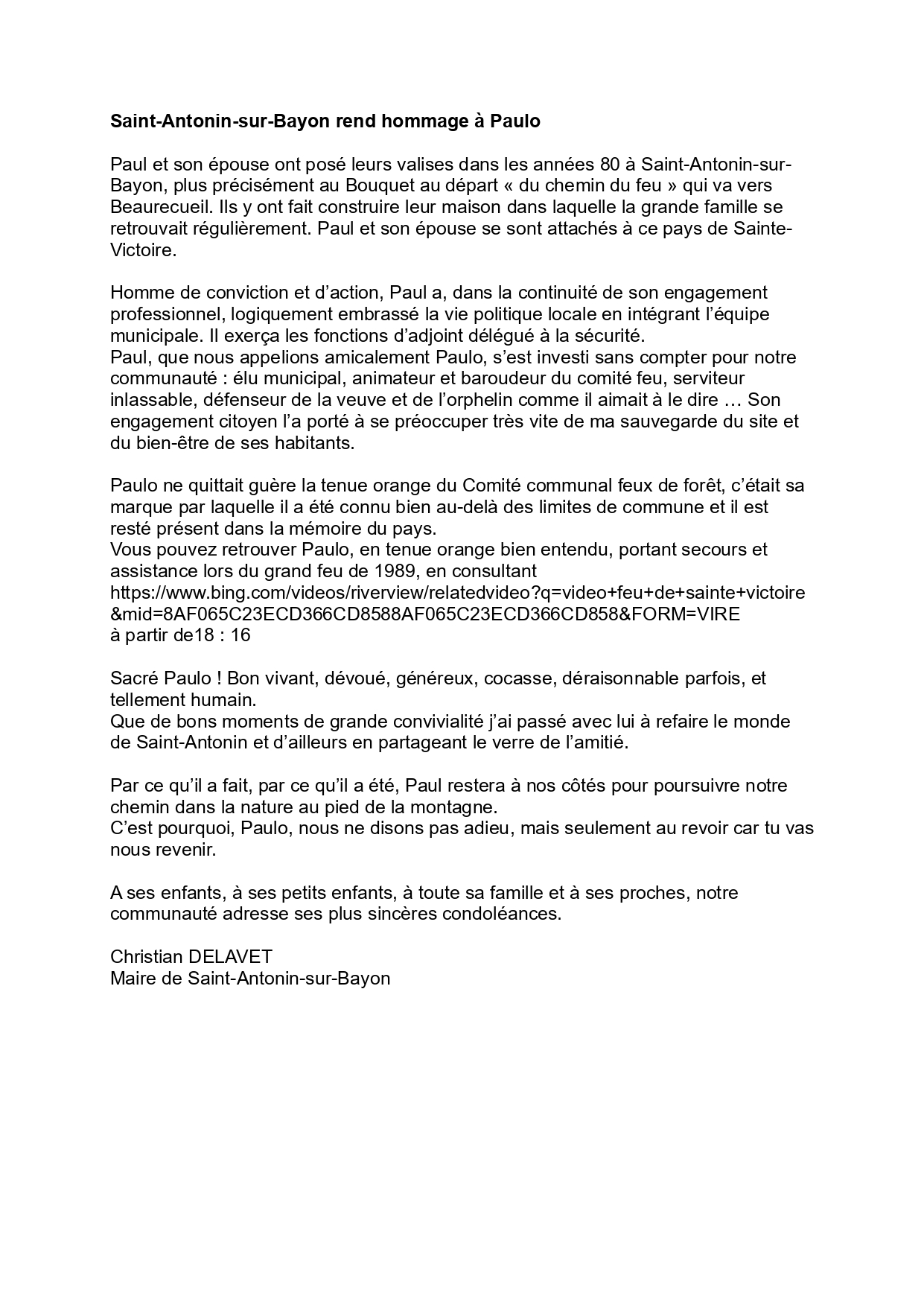Paul BOSQUI
décédé le 23 juillet 2025 à l'âge de 94 ans
Message de la famille
Chère famille, chers amis,
C’est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Paul BOSQUI survenu le mercredi 23 juillet 2025 à La Tour D Aigues.
Nous vous invitons à utiliser cet espace pour laisser vos condoléances, partager des photos souvenirs, une anecdote ou exprimer vos pensées à travers des poèmes ou des textes. Cet endroit est un lieu d'expression dédié à honorer la mémoire de Paul BOSQUI.
C’est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Paul BOSQUI survenu le mercredi 23 juillet 2025 à La Tour D Aigues.
Nous vous invitons à utiliser cet espace pour laisser vos condoléances, partager des photos souvenirs, une anecdote ou exprimer vos pensées à travers des poèmes ou des textes. Cet endroit est un lieu d'expression dédié à honorer la mémoire de Paul BOSQUI.
Déroulé des obsèques
1Cérémonie religieuse
Le mardi 29 juillet 2025 à 15h30
Crématorium de Manosque, 260 Chemin du Grand Vallon, 04100 Manosque
2Crémation
Le mardi 29 juillet 2025 à 15h30
Crématorium de Manosque, 260 Chemin du Grand Vallon, 04100 Manosque
Invitez vos proches à rendre hommage

Pour que toutes les personnes qui tenaient à de M. BOSQUI puissent exprimer un message, un souvenir ou envoyer des fleurs, nous vous invitons à partager cet Espace Hommage autour de vous.

7 hommages
-
-
-
il y a 6 mois
-
il y a 6 mois
-
-
il y a 6 mois
-
il y a 6 mois
history_edu